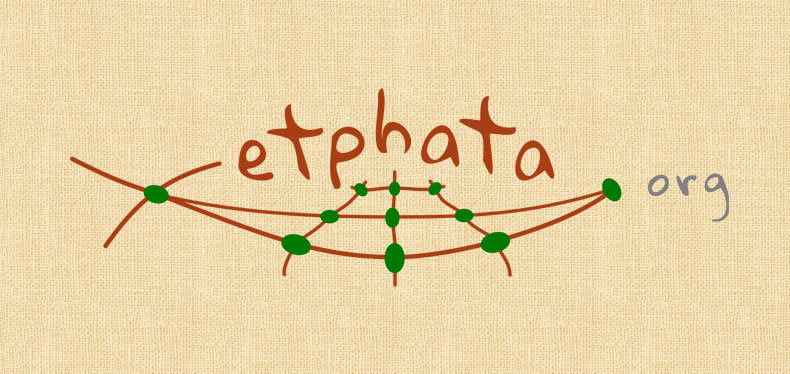Jean 3,12-17
Du serpent d’airain à la Croix glorieuse
par Pierre Perrier, académicien
La logique de Dieu n’est pas celle des hommes. C’est ce que montre la tradition de Moïse et ce que bien des philosophes ont grande difficulté à accepter, trop attachés qu’ils sont à la normativité et au prosaïsme d’un esprit du monde qui peine toujours à accepter la réalité des miracles aussi bien que celle d’un Dieu agissant dans le monde.
Clin d'œil pour un nouveau regard sur la catéchèse :
La racine grecque du surnom de Nicodème étonne toujours un peu : niké, pour la victoire et démos, pour le peuple, autrement dit « la victoire au peuple. » Pour des oreilles modernes cette dénomination évoque immanquablement l’idée si chère à notre époque de démocratie. Mais, ce surnom, ne devrait-il pas aussi être pour nous l’occasion de réfléchir sur les fondements politiques de nos sociétés et sur leur compatibilité avec le Royaume de Notre Seigneur ?
Données introductives sur Jean 3,12-17
| Évangile du dimanche 14 septembre 2025 : | La Croix Glorieuse - Fête du Seigneur |
|---|---|
| Synopse de cet évangile : | Jean 5,22 et 12,47 |
| Niveau d’enseignement : | Niveau supérieur : révélations de Dieu aux mystiques |
| Colliers évangéliques : |
|
Note : Le découpage liturgique des évangiles ne révèle pas leur composition en damiers et en colliers de perles. Rétablir cette connaissance - qui structure l'enseignement donné par Jésus Lui-même - apporterait richesse et facilité d'assimilation à la catéchèse. |
|
Il s’agit du début de l’enseignement théologique de Jésus. Voir page 473 du livre des colliers. |
|
L'Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean
chapitre 3, versets 12 à 17
Note de traduction : pour des questions de droits d’auteur qui nous empêchent de publier le texte commun, nous vous proposons ici une traduction de l'Évangile depuis la Vulgate latine et la Peshitta araméenne. Bien qu'imparfaite, notre traduction cherche à favoriser la conservation du contexte de ces deux traditions ecclésiales. La pertinence de cette page tient davantage au commentaire proposé à sa suite.
- [1]Si Je vous dis les choses en formes terrestres et que vous n’y croyez pas, comment croirez-vous si Je vous les dis en formes du Ciel ?
- Et il n’y a personne qui ait à remonter au Ciel sinon Celui qui est descendu en venant du Ciel : le Fils de l’homme celui qui reste [aussi] présentement dans le Ciel.[2]
- Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il y a de même pour le Fils de l’homme à être élevé,[3]
- pour que tous ceux qui croient en Lui ne soient pas détruits mais que soit pour eux d’être vivants pour l’Éternité.
- Et de même, l’Amour que Dieu a pour le monde [des hommes] et pour son Fils l’Unique engendré, et pareillement, pour tous ceux qui parmi les hommes auront vraiment foi en Lui : ils n’auront pas à craindre leur disparition mais leur seront données des vies qui ne cesseront pas jusqu’à l’Éternité.
- Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde reprenne vie de Sa Main.
Revecez Etphata par email
grâce à notre lettre :
Commentaire et contexte de cet Évangile
Pourquoi Nicodème plutôt que saint Jean ?
Dans l’enseignement que Jésus donne à travers cet évangile, il est question de monter au Ciel et d’en descendre ; ce qui veut dire d’entrer dans une relation intime avec Dieu. Aussi d’aucuns pourraient s’étonner qu’Il s’adresse à Nicodème plutôt qu’à Saint Jean. Le « disciple bien-aimé » n’était-il pas en effet appelé à devenir la grande référence dans ce domaine ; celui qui guiderait vers les Portes du Ciel les croyants de tous les siècles à venir, en leur donnant les clés d’une authentique vie mystique. Dans le récit de la Transfiguration on remarque d’ailleurs que son nom est très significativement associé à celui d’Élie, ce grand prophète de l’Ancienne Alliance dont on dit qu’il fut dispensé de mourir et qu’il accéda directement au Ciel, emporté sur un char de feu.
Si, en présence de Jean (qui en gardera le témoignage), Jésus accepte la visite de Nicodème c’est en fait avec une intention bien précise. Elle touche aux problèmes que la rencontre du monde grec va poser à Son Église ; autrement dit à la confrontation qui va avoir lieu, dès le début du Christianisme, entre d’une part, la tradition religieuse des Hébreux et d’autre part, cet esprit de rationalité dont les Grecs avaient fait depuis quatre siècles leur fonds de commerce philosophique… Une confrontation inévitable et difficile mettant aux prises deux cultures on ne peut plus différentes, mais aussi originales l’une que l’autre.[1]
Qui est Nicodème ?
Comme membre du Sanhédrin, Nicodème devait avoir une solide formation rabbinique. Sans doute a-t-il dû apprendre la langue grecque en fréquentant les écoles d’Antioche, ville cosmopolite fondée par Alexandre et où se faisait fortement sentir l’influence de l’hellénisme.
C’est en tous cas ce que l’étymologie de son surnom grec[2] peut laisser penser. Il est composé de deux termes : niké qui signifie la victoire et démos qui veut dire le peuple. En évoquant ainsi « la victoire du peuple », ces deux mots accolés renvoient évidemment à la spécificité de la pensée grecque ; avec à la fois sa rationalité philosophique et cet intérêt pour le politique qui fera de la Grèce la terre natale de la démocratie... Terme peu compatible avec la conception politique qui fondait la dynastie davidique.
Diffusé au nord-est de la Palestine, l’hellénisme n’a pas manqué de contaminer les élites intellectuelles qui gravitaient autour du Temple de Jérusalem ; introduisant ainsi dans la culture hébraïque des schémas mentaux qui lui étaient tout à fait étrangers.
Revenir à la tradition de Moïse
Nicodème est donc tiraillé entre ces deux cultures, et les miracles que Jésus opère devant lui heurtent sans doute quelque peu son esprit critique. Il les constate cependant et est bien obligé de les regarder comme la preuve que « Dieu est avec Lui ».
Quant au droit dynastique qui fait du rabbi de Nazareth l’héritier légitime du Royaume de David, il ne peut pas ne pas interpeller un intellectuel qui, à l’instar de ses pédagogues, a sans doute rêvé de cités parfaites, organisées selon des lois équilibrées et inflexibles.
A l’évidence la tradition de Moïse procède d’une tout autre logique, et c’est avec cette logique-là que Jésus essaie de le réconcilier ; quelle que soit la difficulté de l’entreprise. C’est ce que semble signifier la phrase qu’Il prononce au cours de leur entretien nocturne et dont Nicodème a d’ailleurs bien du mal à saisir le sens profond : « Nul ne peut entrer dans le Royaume s’il ne naît à nouveau. »
Ce que fonde Jésus n’est ni une démocratie ni un simple humanisme
Un retour à la tradition de Moïse c’est une nouvelle naissance dans la foi. Ce n’est pas une adhésion à un simple humanisme. Ce que le Fils de l’homme vient accomplir sur la terre, aucun homme ne pourrait le faire ; et aucune théorie philosophique ne saurait en rendre pleinement compte.
Jésus n’est ni un être d’exception, ni un héros mythologique qui aurait trouvé le moyen de s’élever par Lui-même jusqu’au trône céleste et d’y dérober le feu sacré. Et Il est encore moins un intello qui prétendrait résoudre les mystères de l’univers en les constituant en un système cohérent et logique. Il est Celui qui est descendu du Ciel, parce qu’Il était déjà au Ciel, assis auprès d’un Père dont Il partageait de toute éternité la nature divine.
Du serpent d’airain à la Croix Glorieuse
L’exemple que Jésus donne à Nicodème pour le ramener à la tradition de Moïse, c’est ce singulier épisode du livre de l’Exode où l’on voit que la logique de Dieu n’est pas de même nature que celle des hommes. Ce récit étrange montre un serpent d’airain (image de maladie et de souffrance) servant de remède et d’antidote pour soigner les morsures de quantité de serpents (elles-mêmes images de toutes les maladies et de tous les drames dont sont accablés les humains).
Récit d’autant plus étrange, que depuis le récit de la Genèse, l’image du serpent est fortement connotée dans la culture hébraïque qui l’assimile à la personne de Satan. Ainsi n’est-il plus seulement le Mal ; par le jeu des analogies, il représente également le Grand Tentateur, c’est-à-dire la source du Mal, sa racine profonde dans le cœur humain.
L’analogie du « serpent d’airain » et de la « Croix Glorieuse » est dès lors de nature à évoquer la radicalité de la victoire du Crucifié : l’Agneau prend sur Lui les péchés du monde pour qu’ils soient brûlés dans l’Amour.
Annoncer la Bonne Nouvelle... nous concerne tous
Invitez vos proches à découvrir ce contenu en leur communiquant l'adresse de cette page (copier l'adresse) ou directement grâce à ces liens pour WhatsApp , Facebook , X (Twitter) , LinkedIn et sinon par email. Nous comptons sur vous.
Pierre PerrierRevecez Etphata par email
grâce à notre lettre :

Entretien de Jésus et de Nicodème
James Tissot - 1886 1894
Brooklyn Museum
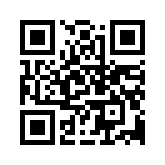
Pour réagir ou partager cette page, retrouvez-la sur votre écran :
URL courte : https://etphata.org/150
Accueillir l'Évangile de ce Dimanche :
Matthieu 4,12-23 - Je ferai de vous des lanceurs de filet pour les enfants des hommes - Évangile du dimanche 25 janvier

Dans la mise en œuvre et la propagation de son Enseignement, Jésus n’emploie ni discours abstrait, ni concept sociologique. Pour concevoir et mettre en place l’appareil qui permettra à ses disciples d’apporter sa Parole aux quatre coins de la Terre, c’est de l’humble métier de pêcheur qu’Il s’inspire ; de l’activité quotidienne de ces modestes artisans de la mer de Galilée qui savent faire ... Lire la suite >>
Évangiles avant et après Jean 3,12-17 :
Marie Mère de l'Église
Et moi j'ai vu et je rends témoignage

Un argumentaire raisonné pour un nouveau regard sur l’histoire de l’Église et des évangiles. Ce livre vient à la suite de Marie Mère de Mémoire et propose nombre de références rendant justice à la qualité des textes canoniques dans la langue de Jésus et mettant en évidence l’organisation de l’Église mise en place par Jésus ainsi que le rôle discret mais essentiel de Marie. Lire la suite >>
Église des origines
Les bonnes nouvelles du Vatican

Nous sommes heureux de vous annoncer deux bonnes nouvelles concernant la recherche sur l’Église des origines. D’une part, la sortie par les presses du Vatican des actes du colloque organisé en 2021 sur le thème de l’histoire des premiers siècles de l’Église. Colloque auquel, comme vous le savez, nous avions largement contribué. D’autre part, dans une lettre publiée ce 21 novembre 2024, ... Lire la suite >>
Un message, un commentaire ?
Pour participer à la vie du site etphata.org :
- Vous avez déjà un compte utilisateur : Se connecter.
- Vous êtes nouveau sur le site : S'inscrire.